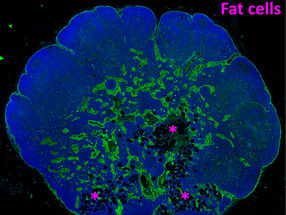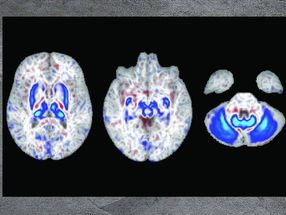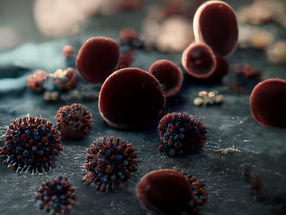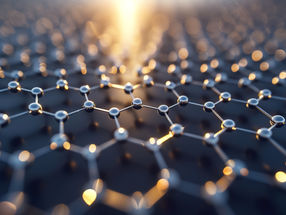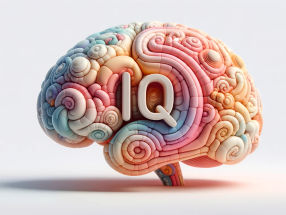Tournant alimentaire vert
Plantes, algues, insectes et champignons - ils sont tous considérés comme des alternatives aux sources de protéines animales et devraient à l'avenir assurer l'alimentation de la population mondiale. Leur avantage : elles contribuent nettement à la protection du climat, à la biodiversité et à une alimentation saine. C'est pourquoi l'attention se porte désormais sur les technologies qui transforment les plantes riches en protéines en produits alternatifs ou qui produiront à l'avenir également de la viande cultivée. Pour 2024, le gouvernement fédéral a débloqué 38 millions d'euros pour investir dans l'évolution de l'alimentation vers des sources végétales et d'autres sources de protéines alternatives. Mais personne ne sait encore si les innovations qui en découlent seront vraiment durables.
C'est là que le projet "Responsible Innovation and Protein Transition" (RI-ProT) doit apporter des éclaircissements. "Nous regardons ce qui existe jusqu'à présent sur le marché en termes de matières premières, de produits et de technologies, mais aussi quels sont les problèmes et où il faudra encore trouver des solutions à l'avenir", explique le Dr Cornelia Rauh, professeur de biotechnologie et de technologie des processus alimentaires. L'objectif final est de créer un radar de l'innovation qui puisse conseiller les acteurs économiques et politiques afin d'évaluer si une innovation dans le domaine des protéines alternatives est responsable et durable.
L'équipe RI-ProT souhaite découvrir ce qui motive l'économie à faire avancer l'innovation, les problèmes auxquels elle est confrontée et ses souhaits. Du côté des consommateurs, il s'agit d'interroger l'état des connaissances dans le cadre de groupes de discussion : Quelles sont les craintes ou les préjugés ? Quel potentiel voit-on dans les nouvelles sources de protéines ? "Le souhait de s'alimenter de manière plus saine, plus naturelle et sans additifs est de plus en plus grand chez de nombreuses personnes", sait Prof. Les questions éthiques, par exemple sur l'élevage des animaux, seraient également de plus en plus discutées dans le Nord global.
La chercheuse en durabilité est également responsable de la promotion de la coopération inter- et transdisciplinaire dans le projet, auquel participent également la chercheuse en systèmes d'innovation Dr Dagmara Weckowska de l'Université libre de Berlin et le politologue Prof. Dr Peter Feindt de l'Université Humboldt de Berlin. Des rencontres régulières avec des associations de l'industrie alimentaire, de l'agriculture et de la protection des consommateurs - également partenaires du projet - sont également prévues. "Il est essentiel de réfléchir au préalable à la manière de soutenir méthodiquement l'échange entre les partenaires très hétérogènes", explique Martina Schäfer.
Le bon vieux ragoût de pois
Pour l'association de sélectionneurs de plantes participant au projet, la question se pose de savoir quelles plantes régionales, comme la féverole ou le lupin, pourraient être cultivées dans notre pays comme sources de protéines. De leur côté, les entreprises réfléchissent à la manière dont elles pourraient proposer les plantes protéiques, par exemple les pois et le lupin, aux consommateurs : naturelles ou transformées en un produit de type escalope ?
Un spécialiste de la Charité doit se pencher sur la question de la santé d'un tel produit transformé. "Peut-être que le bon vieux ragoût de petits pois sera finalement plus sain", s'amuse Cornelia Rauh. Rauh et Schäfer apprécient le fait que des scientifiques de toutes les universités berlinoises et de différentes disciplines travaillent ensemble sur un projet.
Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Allemand peut être trouvé ici.